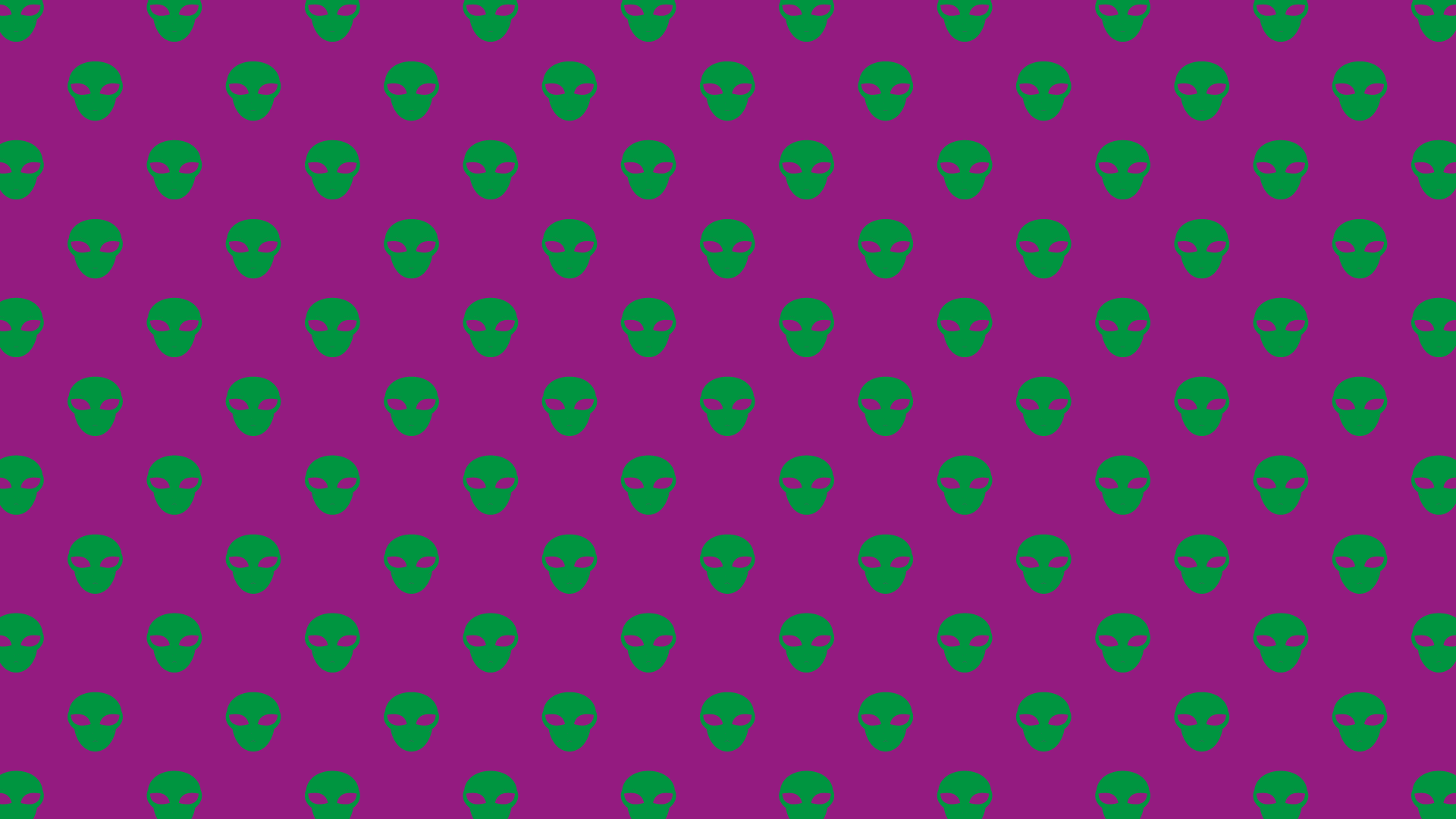
Léos Janacek
Věc Makropulos -L'Affaire Makropoulos
opéra en 3 actes
du 26 octobre 2020 au 6 novembre 2020
| Direction musicale | Tomáš Netopil |
| Mise en scène | Kornél Mundruczó |
| Scénographie | Monika Pormale |
| Costumes | Monika Pormale |
| Lumières | Felice Ross |
| Dramaturgie | Kata Weber |
| Direction des chœurs | Alan Woodbridge |
| Emilia Marty | Rachel Harnisch |
| Albert Gregor | Aleš Briscein |
| Vitek | Sam Furness |
| Krista | Anna Schaumlöffel |
| Jaroslav Prus | Michael Kraus |
| Janek Prus | Julien Henric |
| Dr Kolenatý | Karoly Szemeredy |
| Hauk-Schenkdorf | Ludovit Ludha |
| Machiniste | Rodrigo Garcia |
| Une femme de ménage | Iulia Surdu |
| Une femme de chambre | Iulia Surdu |
Chœur du Grand Théâtre de Genève
Orchestre de la Suisse Romande
Production créée à l’Opera Ballet Vlaanderen en 2016
L'Affaire Makropoulos
Grand Théâtre de Genève
Vos critiques
Vous avez assisté à ce spectacle et souhaitez partager votre avis?
Revue de presse
Letzte Ausfahrt Genf: Abschiedsbesuch von einer Ausserirdischen
Thomas Schacher – Neue Zürcher Zeitung - 31 octobre 2020
source: https://www.nzz.ch/feuilleton/letzte-opernauffuehrung-in-genf-abschiedsbesuch-v…
Das Grand Théâtre hat Pech mit seiner spannenden Produktion von Leoš Janáčeks «Die Sache Makropulos» – die zweite Aufführung war sogleich die Dernière. Und wohl für lange Zeit die letzte Live-Opernaufführung in der Schweiz.
Article réservé aux abonnés de la publication
Geneva’s riveting performance of Janáček’s The Makropoulos Affair with a pre-recorded orchestra
Antoine Leboyer – SeeAndHerad-International.com – 29 octobre 2020
source: https://seenandheard-international.com/2020/10/genevas-riveting-performance-of-…
None of the opera houses currently in activity have been operating under normal conditions. As our Zurich correspondent reported Boris Godunov was performed with an orchestra whose live playing was relayed in real time whereas L’elisir d’amore had no chorus. In Munich, a reduced-sized orchestra played Wozzeck not down in the pit but at orchestra level. Opera houses have to adapt and innovate but are ultimately forced to make some compromises. Otherwise, they cannot stay open.
Geneva’s Grand Théâtre used an even more radical solution as the one Zurich did for Boris. In July, the Orchestre de la Suisse Romande assembled under Tomas Netopil and recorded the orchestral part in a studio. This is this recording which is being used for all the performances. Conductor Netopil is present to give singers their cues, but the pit is filled with loudspeakers. This is an orchestra-less performance.
One cannot escape the fact that the conductor standing above an empty pit felt … weird. A little more muscle from the musicians would have been welcome. This was the first time in thirteen years that the Swiss Romande Orchestra was performing Janáček. Surely they should have gained familiarity with the Czech composer’s unique colours and style. It was far from being a first reading but Janáček’s afficionados would have felt they were playing it safe here and there.
But did it matter ?
The Makropoulos Affair is an unusual opera. It is an intense fast-paced three-act drama, until the last five minutes when the pace slows down, and we are given a genuine Janáčekian and very moving long-line aria. Most productions typically struggle to simply tell the story. Many (English) theatres cheat by replacing the Czech language with a translation to help the audience follow what is, to put it mildly, a convoluted story. Many spectators may not admit it, but it is not easy to follow what is happening. This was not the case here. This production was originally created at Antwerp Opera in 2017 and received multiple accolades. It was a natural choice for General Manager Aviel Kahn to bring it along from his former theatre, with most of the original cast, for his second season in Geneva.
Hungarian Kornél Mundruczó is probably better known for his work as a film director, having won the special category ‘un certain regard’ at the Cannes Film Festival for his movie White God. There were many cinematographic qualities in this production: in the clever usage of video projections but also in the general intensity of the whole concept.
Emilia Marty is not presented as a glamorous singer. As the work progresses, one discovers a frail figure spitting dark blood and having lost all humanity, physically and mentally. Her third act dramatic confession felt like a logical step after all that had taken place. Around her, the many characters in the work were sharply portrayed: Albert’s passion, the darkness of the Baron as well as his reaction to the suicide of his son, Krista’s fascination and admiration towards Emilia Marty, in the end refusing to follow her path. The quality of the Personenregie was at the level of spoken theatre, something one rarely encounters in opera houses.
The cast was very strong overall. Aleš Briscein has phrasing and tension in the difficult part of Albert, Emilia’s grand-grand-grandson (I lost track of the number of generations). Michael Kraus took a bit of time to fully find his mark but the grief of the father who realizes his son has killed himself and his own darkness was gripping. Minor roles were well cast.
But central to this is Rachel Harnisch’s portrayal of Emilia. As we have all learned from Gérard Mortier, the real twentieth-century composer of modern heroines is not Richard Strauss. The Swiss soprano did not attempt to find cream and sugar in Janáček’s music. It was a precise and sharp reading with significant psychological insights. Intonation was faultless. The physicality of the acting was mesmerizing. There was not a single moment when this great artist failed to fully inhabit her demanding part.
So, did we miss an orchestra, or did it feel artificial? A few minutes after the gripping start, nothing else really mattered. We were hooked on the story and the tension only came down a few hours later, with the final bars portraying Emilia’s death.
Production lyrique insolite – Une affaire très spéciale au Grand Théâtre
Rocco Zacheo - Tribune de Genève - 12 septembre 2019
source: https://www.tdg.ch/une-affaire-tres-speciale-au-grand-theatre-968472176382
Article réservé aux abonnés de cette publication
Le coronavirus donne le la
Claudio Poloni - ConcertoNet.com - 26 octobre 2020
source: http://www.concertonet.com/scripts/review.php?ID_review=14557
Le coronavirus oblige les théâtres lyriques à faire preuve d’inventivité. Il y a un mois, l’Opernhaus de Zurich présentait Boris Godounov avec une fosse vide : pour chaque représentation, le chef, les chanteurs et les choristes étaient rassemblés dans un studio de répétition situé à un kilomètre du théâtre, le son étant retransmis dans la salle par fibre optique et les interprètes suivant les indications du chef grâce à de nombreux écrans installés tout autour du plateau. Le Grand Théâtre de Genève va encore plus loin : en juillet, le chef Tomás Netopil et l’Orchestre de la Suisse Romande commençaient les répétitions de L’Affaire Makropoulos. Anticipant l’évolution de la pandémie et compte tenu aussi de l’effectif orchestral imposant du chef-d’œuvre de Janácek, le Grand Théâtre et l’Orchestre décidaient d’un commun accord d’enregistrer la partie orchestrale. Grand bien leur en a pris, car sinon le spectacle n’aurait sûrement pas pu avoir lieu, vu la situation sanitaire actuelle. C’est donc une bande-son enregistrée que le public genevois entend, diffusée dans la salle par une trentaine de haut-parleurs disposés dans la fosse. Le chef est seul présent dans la fosse, à donner des indications aux chanteurs. Une représentation d’opéra sans musiciens dans la fosse, qui l’aurait jamais imaginé ?
L’entreprise n’a pu être réalisée que parce que le chef et la plupart des chanteurs connaissaient déjà la production, pour l’avoir étrennée à l’Opéra des Flandres en 2016. Tous connaissaient les tempi dont le spectacle a besoin. Il n’empêche, il faut s’incliner devant la performance des interprètes, au premier rang desquels Rachel Harnisch dans le rôle principal, lesquels n’ont aucune souplesse ni marge de manœuvre et doivent impérativement se caler, à la seconde près, sur la bande-son. Le résultat est d’autant plus impressionnant que le soir de la première aucun décalage sensible ne s’est fait entendre. L’équilibre orchestre-chanteurs est aussi bien assuré. Spécialiste de Janácek, Tomás Netopil offre une lecture claire et transparente, mais aussi ronde et pointue à la fois, avec un grand souci du détail, sans pour autant perdre de vue l’urgence et la tension dramatique. Pour la petite histoire, on notera que L’Affaire Makropoulos est donnée pour la première fois au Grand Théâtre de Genève, signe que l’ouvrage, réputé difficile et complexe, peine à se faire une place durable sur les affiches lyriques.
La mise en scène de Kornél Mundruczó nous révèle tout de suite que nous avons affaire ici à la production d’un cinéaste, tant l’intrigue est traitée comme un thriller, dans une atmosphère mystérieuse, inquiétante et fantomatique - à l’image de l’opéra tout entier – atmosphère rehaussée par les superbes lumières de Felice Ross. L’action est d’abord transposée dans un tribunal, avec des juges façon Robocop, puis dans une villa moderne et cossue. La direction d’acteurs est particulièrement soignée, chaque personnage étant finement caractérisé et chaque réaction et sentiment traduits au plus juste.
La distribution très homogène et de haut vol est emmenée par Rachel Harnisch, Emilia Marty à la silhouette juvénile et élancée, presque androgyne, qui fait son entrée en combinaison de motard. Héroïne tour à tour féline, cynique et narquoise, mais aussi désabusée, émouvante et fragile, la soprano suisse éblouit tant vocalement que scéniquement, ne faisant qu’un avec son personnage. Elle ne saurait être mieux entourée par Ales Briscein, Albert Gregor ardent et passionné, au lyrisme incandescent, et par Michael Kraus, Jaroslav Prus au magnifique timbre ambré. Malheureusement, seule une poignée de privilégiés pourront voir ce spectacle à Genève car la série de représentations devrait s’arrêter après la deuxième déjà, le gouvernement suisse venant de limiter les manifestations à cinquante personnes pour une période encore indéterminée.
Rachel Harnisch est Elina Makropoulos
Charles Sigel - ForumOpera.com - 28 Octobre 2020
source: https://www.forumopera.com/laffaire-makropoulos-geneve-geneve-rachel-harnisch-e…
Comme c’est étrange une salle d'opéra où l’on n’entend pas l’orchestre se chauffer avant le lever de rideau, où le public, masqué, du coup chuchote ou se tait, où beaucoup de sièges sont vides, non seulement parce que les règles le demandent, mais parce que certains ont eu peur de venir. Atmosphère glaçante, qu’on pourrait voir cyniquement propice à un opéra aussi déconcertant que L’Affaire Makropoulos.
Le Grand Théâtre de Genève le propose dans une formidable lecture, due au cinéaste hongrois Kornél Mundruczó et créée à l’Opéra des Flandres, à Anvers en 2016.
Oui, tout est saisissant dans ce qu’on voit là, et d’abord la performance de Rachel Harnisch dans le rôle d’Emilia Marty, alias Elena Makropoulos, alias… alias…
C’était annoncé, on a choisi ici, puisque les distances de sécurité sont impossibles à respecter dans la fosse, d’enregistrer l’énorme effectif orchestral sur une bande-son, qui sera diffusée par une batterie de haut-parleurs, petits et grands, répartis dans la fosse d’orchestre. Le chef Tomáš Netopil est à son poste, dirigeant ses musiciens virtuels, ceux de l’Orchestre de la Suisse romande. Première impression déconcertante : l’ouverture n’a pas, malgré ses fanfares, l’éclat, la netteté, le piqué, qu’on lui connaît habituellement (c’est une des plus puissantes pages d’orchestre de Janáček), mais une sorte de rondeur (difficile de situer dans l’espace les violons ou les cuivres ou les bois). Cette gêne, ce sentiment insolite s’effaceront dès qu’apparaîtront les chanteurs, non sonorisés, eux, et l’équilibre scène-fosse sera parfait, avec un orchestre qui, grâce à un chef tchèque, sera dans l’esprit de Janáček, c’est-à-dire acerbe, nerveux, précis, pointu.
Sujet apparent et sujet réel
Leoš Janáček, pour son avant-dernier opéra, composé au cours de son invraisemblablement féconde septantaine, jette son dévolu sur une pièce de Karel Čapek, jeune écrivain tchèque qui sera aussi fameux que Jaroslav Hašek, le père du soldat Švejk. Čapek est une sorte de Jules Verne : il invente l’avenir, le clonage, les manipulations génétiques, l’intelligence artificielle, les robots (le mot et la chose en 1921). Ce qui l’intéresse, ce sont les conséquences que de telles nouveautés ont sur l’âme humaine.
L’Affaire Makropoulos n’est pas tant une œuvre de science-fiction, qu’une sorte de variation sur l’idée de la vie éternelle. Vaincre la mort, utopie portée par combien de mythes. Ici, ce n’est pas la science qui aura permis à l’héroïne d’atteindre l’âge de 337 ans, mais un mystérieux élixir, autour duquel tournera l’intrigue.
Cette intrigue, ce serait trop long de la raconter ici, d’autant qu’elle est tarabiscotée, que tout va très vite, que les personnages parlent beaucoup et à toute allure, que Janáček écrit nerveux et serré, et qu’il y a, comme on disait jadis au cours de grammaire, un sujet apparent et un sujet réel.
Le sujet apparent, c’est un conflit juridique, une contestation d’héritage entre Albert Gregor (un fougueux ténor) et le baron Jaroslav Prus (l’intrigant baryton), une histoire obscure de paternité contestée au dix-neuvième siècle.
Le sujet réel, c’est Emilia Marty. Elle s’immisce dans l’affaire (au sens juridique), car elle est a appris que l’héritage en question, ce n’est pas seulement un domaine (dont elle se contrefiche) mais aussi un lot de papiers, dont une certaine enveloppe jaune, contenant un pli cacheté.
« Ne me posez pas de questions »
L’opéra commence vraiment quand elle surgit inopinément dans le cabinet de l’avocat Kolenatý. Apparition spectaculaire de Rachel Harnisch, gracile, presque émaciée, en tenue de motard, lunettes noires, casque à la main. Elle a les cheveux blonds et courts de Rita Hayworth dans La Dame de Shanghaï. Silhouette androgyne, elle remonte sans cesse son jean, comme un garçon. Tout au long de l’opéra, dans ses multiples transformations, elle gardera cette ambiguïté sexuelle, paradoxale chez cette hyper-femme, dévoreuse d’hommes.
Pour l’heure, exaspérée, autoritaire, vénéneuse, elle arpente la scène à grands pas. Sans cesser de parler-chanter. Les mots et la musique s’imbriquent dans une marqueterie virtuose. Janáček joue d’une panoplie de minuscules thèmes (leitmotives serait un grand mot, mais il y a de ça), qu’il varie à l’infini. L’orchestre commente, ponctue, ironise, brode une tapisserie sonore au petit point. C’est en fait lui le protagoniste principal. Symphonie modern’ style avec solistes obligés…
Série noire
La grande force de la mise en scène de Kornél Mundruczó, c’est de rendre plausible l’invraisemblable. Comme on le sait, le fantastique est comme chez lui dans le banal. Un cabinet d’avocat au premier acte (une grande table, comme le banc des juges d’un tribunal, devant un imposant panneau lambrissé), au deuxième et au troisième acte le salon d’Emilia Marty, ambiance presque contemporaine, celle d’une série noire des années soixante, mobilier style scandinave, cheminée, grande baie derrière laquelle frissonnent des arbres, un lit au fond, un bar, un frigo. On pense à Mulholland Drive (Emilia Marty portera tout-à-l’heure la perruque de la fille blonde). Quant aux multiples personnages masculins, qui apparaissent sans qu’on nous en dise grand-chose, leurs silhouettes sont dessinées par une direction d’acteurs au cordeau : l’ennuyeux avocat Kolenatý (Karoly Szemeredy), qui ânonne les tenants et aboutissants du litige, le clerc éméché Vitek (Sam Furness), le retors et raide baron Prus (Michael Kraus), la distribution masculine est impeccable, les voix sont belles, mais il faut dire que la partition ne leur permet que peu de grands élans. C’est une conversation virtuose en musique : Janáček, on le sait, se promenait dans la rue avec un carnet dans lequel il notait musicalement le phrasé des passants, leur manière d’accentuer la langue tchèque. Son écriture lyrique en est le reflet, les mots passent avant les notes.
Fous d’elle
Seul parmi les protagonistes masculins, le jeune Albert Gregor, qu’Emilia Marty appelle Bertik, est gratifié de bouffées de lyrisme. Dès qu’il comprend que la mystérieuse jeune femme connaît très bien les arcanes de cette vieille affaire embrouillée (et pour cause : elle y était), il lui déclare sa flamme et le ténor Aleš Briscein peut alors montrer la beauté de sa voix, puissante et rayonnante, la solidité de ses aigus, en même temps que ses talents d’acteur. Au dernier acte, on le verra, toujours éperdu, offrir des bijoux à la dame, qu’elle dédaignera : « Ils deviennent tous fous d’elle dès qu’ils la regardent », dit l’un des personnages.
La folie, c’est littéralement le lot du personnage de Hauk, qu’incarne avec truculence le ténor Ludovit Ludha : cet homme est devenu fou d’elle quand elle était une « gitana endiablada » sous le nom d’Eugenia Montez, l’un de ses avatars. Puisque Emilia Marty fut aussi Ekaterina Myshkin, Else Müller, Elian MacGregor… et surtout Elina Makropoulos, fille de Hieronymos Makropoulos, chimiste de l’Empereur Rodolphe, et qui inventa pour lui un philtre d’éternelle jeunesse, qu’il essaya d’abord sur sa fille âgée de seize ans.
« Mais que vous importe une femme morte depuis longtemps ? »
Telle est la clé du secret Makropoulos, et le sujet réel de l’opéra. Voilà pourquoi cette femme qui a vécu plusieurs vies, qui a connu avec indifférence de multiples amours, arrive épuisée devant nous. « Comment supporter 300 ans d’une vie pareille ? », dit-elle. Elle prend de mystérieuses pilules, on lui place même une transfusion, à l’évidence la potion magique ne fait plus effet, et c’est du mystérieux document scellé, qui recèle la formule du philtre, qu’elle espère un nouveau sursis. Elle couchera même avec le baron pour le lui arracher.
Au deuxième et au troisième acte, on verra Rachel Harnisch se dépouiller petit à petit de plusieurs couches de vêtements, puis arracher ses cheveux, pour apparaître finalement le crâne rasé et vêtue de bandelettes, telle une momie. Image impressionnante, violente, glaçante. « Vous aimer est pure perversité », lui avait dit Albert. Quand elle aura tout arraché d’elle-même, son passé, ses identités, les femmes qu’elle fut, ses oripeaux, ses cheveux, et finalement son secret, que restera-t-il ? Rien. Sinon la mort. « Je t’aime », lui dit-il. « Alors tue-moi ! » répond-elle.
La performance physique de la chanteuse est aussi stupéfiante que sa performance vocale et l’une et l’autre sont tellement mêlées qu’il serait illusoire de distinguer l’une de l’autre. On la voit se défaire, se détruire, se décomposer sous nos yeux, très loin de la motarde sur les nerfs qu’elle fut une heure avant.
« Si vous saviez comme vous êtes heureux »
Tout le mouvement de l’opéra de Janáček conduit à une scène finale de quelque huit minutes, où la musique change. Au ping-pong des répliques, succèdent des valeurs longues. Enfin une mélodie s’élève, lancée par le violon et qu’avait annoncée l’ouverture. La voix de Rachel Harnisch gagne alors une plénitude superbe. « Je vois la main de la mort sur moi, vous n’êtes plus que des objets et des ombres », dit-elle à tous ces hommes qui ont fait son procès. Elle renonce à vivre une vie de plus, elle donne le fameux document à la jeune Krista, fille de Vitek, qui le brûlera. « Vous êtes si heureux, [vous qui vivez dans le temps], moi toute âme est morte en moi ! »
Et la musique n’est jamais aussi belle que quand Emilia Marty en appelle finalement au Christ, Ježiši Kriste. Ses derniers mots seront « Pater hemon », Notre Père, dans le grec de son enfance.
A ce moment-là, le décor de série noire, et les comparses auront disparu dans l’obscurité, les meubles se seront envolés, il ne restera sur le plateau vide que cette blafarde silhouette, qu’on verra disparaitre dans les profondeurs, tandis qu’apparaîtront les deux lettres E.M.
Une production selon nous marquante, s’il est vrai que l’opéra, c’est la fusion du théâtre et de la musique. Et du sens.
Une affaire Makropoulos sans tambour ni trompette
Jacques Schmitt - ResMusica.com - 28 octobre 2020
source: https://www.resmusica.com/2020/10/28/a-geneve-une-affaire-makropoulos-sans-tamb…
Dans un contexte de représentations lyriques étouffées par les contraintes du Covid-19, L’Affaire Makropoulos de Leoš Janáček foule avec succès et pour la première fois la scène du Grand Théâtre de Genève.
Restrictions de jauges théâtrales obligeant, le Chœur du Grand Théâtre de Genève et l’Orchestre de la Suisse Romande ne sont pas physiquement présents dans la fosse d’orchestre. C’est donc sans tambour ni trompette, ni cordes ni bois, mais depuis une bande sonore que cet opéra est présenté à un public disséminé en respect des distanciations sociales en vigueur. S’il faut reconnaître à la direction du Grand Théâtre de Genève les audaces et les efforts consentis pour que ce spectacle puisse être montré sous l’adage : « The show must go on ! », l’absence d’orchestre de fosse se ressent. La bande, issue des répétitions d’orchestre faite quelque trois mois auparavant, pour complète qu’elle soit manque de l’instantanéité, de la réponse du moment que la scène renvoie au chef d’orchestre. Ainsi, quand bien même le chef Tomáš Netopil, seul depuis la fosse dirige les chanteurs avec une précision millimétrique, il ne peut donner l’élan artistique que demande un théâtre d’opéra.
Parce qu’avec L’Affaire Makropoulos, on est plus près du théâtre parlé que de l’opéra. Dans cette œuvre particulièrement difficile, l’écriture musicale de Leoš Janáček joue un rôle primordial dans l’accompagnement et l’illustration du livret. Beaucoup de mots, beaucoup de phrases très courtes, les dialogues se suivant à un rythme effréné, énoncés dans une langue (tchèque) qu’on ne connaît pas sous nos latitudes latines, forcent le spectateur à continuellement se référer aux surtitres pour suivre l’action. Un bavardage intense déstabilisant pour qui n’est pas un tant soit peu préparé à cet opéra et à son intrigue.
Dans sa mise en scène, le cinéaste hongrois Kornél Mundruczó s’efforce à rendre l’action aussi limpide que possible, encore que certaines « trouvailles » questionnent leur bien-fondé. À l’exemple de ces avocats-motards, de ce frigo aux vapeurs jaunes qu’on ouvre ou qu’on ferme sempiternellement, de cette héroïne tatouée, de cet éclairage oscillant et aveuglant. Certes, Kornél Mundruczó nous montre un monde en décadence où l’héroïne, Emilia Marty, à la recherche de l’enveloppe renfermant le secret et la formule de longue vie inventée par son père, finalement décide de quitter, après plus de trois-cents ans, une vie d’amours et de désillusions répétitives. Dans ce tourbillon de personnages, de dialogues partant dans tous les sens, mêlant amours déçues et disputes successorales, la cohésion scénique s’avère difficile à pleinement réaliser.
Le parti pris du metteur en scène d’imaginer Emilia Marty, alias Makropoulos, en une star d’avant-garde provocatrice gomme tout aspect poétique, voir romantique du personnage. Il dépeint ainsi une femme dont la dégradation physique rapide la couvre de laideur. Hématomes aux jambes, cicatrices, et chevelure absente, en contradiction avec l’extraordinaire chanteuse d’opéra qu’elle incarne aux yeux des autres. La soprano suisse Rachel Harnisch s’insère parfaitement dans les habits du personnage voulu par son metteur en scène. Froide, consciente de sa notoriété, elle joue cette comédie tragique avec autorité et intelligence. Mais reste l’artiste qui ne peut réfréner son instinct et, c’est en formidable chanteuse, qu’elle efface cet aspect désolant de son personnage dans un bouleversant final où elle parvient, malgré les bandages qui lui enserrent la poitrine, malgré les genouillères et la tête chauve, à sublimer dans un élan lyrique extraordinaire la musique de Janáček, la conscience humaine renaissant au moment de la mort.
À côté d’elle, la distribution vocale est d’une très belle homogénéité. Les voix sont fortes, admirablement timbrées. Très bien dirigés, tous ces rôles secondaires se potentialisent les uns les autres, faisant sens à leurs actions et portant une belle unité théâtrale. On aura remarqué particulièrement l’autorité du ténor Aleš Briscein (Albert Gregor), comme celle de Sam Furness (Vitek) et l’immense et magnifique voix de Michael Kraus (Jaroslav Prus).
Certes la scène du Grand Théâtre de Genève a rarement eu l’occasion d’aborder des œuvres aussi complexes et difficiles que L’Affaire Makropoulos de Janáček mais la qualité de cette production (nonobstant les quelques problèmes cités plus haut, en raison de la situation actuelle) mérite amplement le succès que lui a réservé le public.
Affaire Makropoulos sans fosse mais pas sans force
Damien Dutilleul - Olyrix.com - 27 octobre 2020
source: https://www.olyrix.com/articles/production/4425/affaire-makropoulos-leos-janace…
Le Grand Théâtre de Genève poursuit sa saison avec L’Affaire Makropoulos, accompagné d’un orchestre enregistré, proposant ainsi à contrecœur à ses spectateurs une expérience unique en son genre. Verdict :
Rachel Harnisch prête son corps, son sourire intrigant et sa voix charnue au timbre décharné à Emilia Marty, dans une prestation intense. Sa densité vocale, opulente dans le registre médian, s’allège dans l’aigu. Ses graves sont aigres à dessein, dessinant la psychologie d’un personnage vidé de tout ressenti. Sa technique s’appuie sur un contrôle sans faille du souffle et un vibrato rond dont les lèvres battent le rythme.
Anna Schaumloffel, Kristina à la fraicheur contrastant avec Emilia, délivre un mezzo intense et appuyé, au timbre soyeux, au phrasé percutant. Le Vítek de Sam Furness, homme ivre et perdu, se montre attachant. Sa voix mate présente un timbre corsé et charmant, bien émis. Ludovit Ludha est un Comte Hauk-Sendorf sortant de l’imaginaire d’Emilia Marty. Personnage à la fine exubérance, il porte le grincement de l’ironie et la chaleur de l’amour dans son timbre. Julien Henric (Janek Prus) dispose d’un ténor placé haut et d’un timbre clair et froid. En Femme de chambre, Iulia Surdu s’affaire, délivrant ses interventions avec une diction précise, d’une voix cuivrée et couverte, qui tend à se perdre lorsqu’elle est en fond de scène. Le Machiniste de Rodrigo Garcia dispose d’une voix au grave patiné et projeté.
Un grand spectacle, hélas mort-né
Guy Cherqui - Wanderersite.com - 9 novembre 2020
source: https://wanderersite.com/2020/11/un-grand-spectacle-helas-mort-ne/
Les productions adaptées à la pandémie ont continué au Grand-Théâtre, qui vient d’être distingué Opéra de l’année 2020 par les International Opera Awards.
Après Cenerentola qui remplaçait la Turandot initialement prévue, voici l’Affaire Makropoulos, belle production du cinéaste hongrois Kornél Mundruczó venue dans les bagages d’Aviel Cahn qui l’avait proposée à l’Opéra des Flandres en 2016 avec pour l’essentiel la même distribution et le même chef. Mais l’orchestre de Janáček est lourd et par précaution, l’OSR avait enregistré l’œuvre en juillet dernier.
La vie du Coronavirus étant riche et obéissant au motto croissez et multipliez, Aviel Cahn a proposé de présenter la production avec l’orchestre enregistré, plutôt que de renoncer, car les conditions de la fosse de Genève ne permettent pas une distanciation acceptable pour les musiciens.
Las, la production s’est arrêtée après la deuxième représentation, le Conseil Fédéral interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. On ne peut que le regretter, parce que le spectacle n’a rien perdu de sa puissance ni de son efficacité dans cette nouvelle présentation qui aura vécu une si courte vie : mort-née.
Mort-née
On peut discourir sur les raisons d’avoir réduit à 50 ou en Bavière en Suisse les jauges des théâtres, c’est une manière de les fermer sans le dire. Autant faire comme en France, où l’on ferme, sans autre forme de procès, le théâtre et le cinéma n’étant pas des « activités essentielles » (…). Pour simplifier, 50 (mais aussi 200–300) personnes assises sagement les unes distancées des autres qui ne bougent pas et ne parlent pas, qui restent masquées, n’ont rien à voir avec 50 personnes lors d’une fête de mariage. Bien sûr, comme je l’ai entendu de la bouche d’une de nos excellences « il faut empêcher les socialisations », et les socialisations au théâtre ont lieu durant les entractes (il n’y en avait pas pour Makropoulos) ou au moment de l’entrée et la sortie. L’entrée étant organisée selon un circuit balisé on ne socialise guère en entrant, et la sortie rapide et assez distanciée fait que les gens socialisent dehors (mais s’il pleut…).
Il faut en revanche reconnaître que les institutions culturelles ont déployé des trésors d’imagination et dépensé de grosses sommes pour maintenir l’activité : à Vienne ou à Salzbourg, on a testé et on teste à tour de bras pour que les représentations aient lieu « normalement ». En Italie, on a mis les spectateurs dans les loges et l’orchestre au parterre. À Zurich, on a mis l’orchestre à distance en-direct, avec un système de transmission sophistiqué qui n’a pas si mal fonctionné pour Boris Godunov, à Genève si le chef est en salle, dirigeant les chanteurs, on a enregistré l’orchestre, et le chef dirige aussi l’ingénieur du son qui gère l’enregistrement, montant ici, baissant là pour essayer de respecter les équilibres sonores voulus. Tout cela a coûté du temps et de l’argent, pour garantir au spectateur un spectacle digne même dans des conditions spéciales. Et ces efforts d’imagination (qui ont porté leurs fruits : pas de clusters dans les théâtres ou cinéma, on l’aurait su…) tombent à l’eau parce que tout ferme. Notre santé n’a pas de prix…
Ainsi donc voici le critique conduit à critiquer un spectacle non pour inciter le spectateur potentiel à aller le voir, mais pour « faire date », dans l’amertume – dans le cas de Genève – de savoir que tous les spectacles jusqu’à Noël sont annulés. Pas de Candide donc, nous resterons à cultiver notre jardin chez nous…Les deux premières années d'Aviel Cahn sont pour le moins perturbées.
Ainsi donc cette Affaire Makropoulos signée Kornél Mundruczó a eu le mérite de faire connaître à Genève non seulement un opéra qui n'y a jamais été représenté, mais aussi une nouvelle figure de la mise en scène d’opéra. Après deux spectacles en Hongrie, Mundruczó qui est cinéaste et acteur a été invité par Aviel Cahn à monter Le Château de Barbe Bleue et Le voyage d’hiver en 2014 à l’Opéra des Flandres et l’Affaire Makropoulos en 2016 récompensée en 2017 par un International Opera Award. Genève a donc le privilège d’être l’un des tout premiers opéras en Europe à présenter son travail alors qu’au théâtre il a déjà pas mal travaillé, en Allemagne notamment.
Les mises en scène de L’Affaire Makropoulos sont souvent focalisées sur la figure de la Diva, ou de la Star, que ce soit la mise en scène très traditionnelle de Elijah Mojinski au MET, ou celle extraordinaire sur le monde du cinéma hollywoodien de Warlikowski à Paris et Madrid, ou bien celle très récente de Tcherniakov à Zurich, qui explore la gloire par la téléréalité. Le personnage central est starisé, il est déjà exception, avant même son aventure trans-temporelle.
La justice broie du noir : Rachel Harnisch (Emilia Marty)
Mundrukzó prend l’histoire à revers et en fait un drame de l’individu, entre fiction et réalité, partant de la salle d’un tribunal dominée par le tableau « Justice » de Pierre Subleyras (actuellement au Musée Thomas-Henry de Cherbourg) peint au XVIIIe, envahie d’étranges motards en cuir noir et encasqués, comme on imagine des sbires de la Mafia.
Il y a quelque chose de surréaliste dans cette vision initiale, qui part donc de ce dossier tentaculaire de règlement sans fin d’une histoire d’héritage qui constitue la vie parallèle de l’héroïne à travers la longueur de son âge, une vie parallèle qui ne l'intéresse qu'indirectement, parce que les papiers en questions cachent un document essentiel pour elle.
En fait ces motards patibulaires et mafieux cherchent le fameux papier autour duquel toute la trame va se structurer, qui est la formule de l’élixir d’immortalité qu’a bu Elina Makropoulos au XVIIe. Et parmi ces motards apparaît Emilia Marty.
Dans sa mise en scène au Teatro Regio de Turin il y a une trentaine d’années, à une époque où peu de théâtres occidentaux osaient autre chose que Jenufa, Luca Ronconi avait placé l’Affaire Makropoulos dans d’immenses rayonnages de bibliothèques ou d’archives (décors de Margherita Palli) : déjà l’idée de l’accumulation de papiers, de souvenirs, de traces, de strates, était très présente, comme une sorte d’étouffoir.
Et c’est bien ce qu’est ici cette œuvre, sorte de dernier jour d’une condamnée à vivre et lasse de vivre, parce qu’avec le temps les émotions l’ont fuie, plus rien n’a de prise et la mécanique des sentiments, des passions, des hommes qui l’adulent l’ont épuisée.
L’idée que l’immortalité est un piège, que la vie ne prend sens que dans l’existence de la mort n’est évidemment pas nouvelle, mais elle prend dans la comédie de Karel Čapek une forme originale, presque débarrassée de tout aspect surréel, mais bien ancrée dans le réel, à l’égal d’une comédie dramatique. Čapek est un spectateur amusé et sarcastique du monde, un esprit libre et vif, donc dangereux, qui a recours fréquemment au fantastique, il mourra en 1938 peu avant que la Gestapo ne l’arrête pour l’envoyer dans les camps. Il y a donc dans cette œuvre aussi bien du drame que de la comédie, et c’est bien ce qui fait aussi son prix et sa singularité.
Pendant l’ouverture une longue scène en vidéo, course à l’abîme en moto à travers une route au paysage boisé qui ressemble à certains paysages de Bohème figure en quelque sorte le parcours d’Elina, course à la vie, puis course à la mort et enfin – ce qu’on va voir, course au document qui est la clef de sa vie et de sa mort.
En effet, la salle de tribunal initial qui fait face au public, visitée par un groupe de motards mafieux à la recherche d’on ne sait quoi est en fait l’épisode parallèle à la vie d’Emilia Marty (ou Ellen McGregor ou Elina Makropoulos ou Eugenia Montez etc…) depuis le début du XIXe siècle, une affaire d’héritage qui s’étire, comme pour justifier de l’existence prolongée d’Emilia.
Cette première partie assez courte explicite la situation d’Emilia, le procès Prus/Gregor, qu’elle semble parfaitement connaître à l’étonnement de tous. Elle apparaît elle aussi vêtue en motard noir, elle aussi à la recherche des documents et du testament. On comprend alors que la vidéo initiale était une métaphore de son parcours de sa course, qui va devenir l’espace de l’opéra une course à l’abîme.
Et dans toute la deuxième partie (les deux derniers actes) Emilia évolue dans cet appartement aux lignes géométriques glaciales et sans âme qui va devenir l'espace glacé d'une contradiction, d’un côté des personnages qui pourraient être des personnages de théâtre bourgeois, qui s’agitent autour de la Diva, c’est l’image qu’on en a dans la mise en scène de Tcherniakov à Zurich ou de théâtre assez proche de la revue hollywoodienne comme chez Warlikowski, de l'autre un mythe qui va se démythifier au cours de l’histoire.
Mundruczó crée en effet un hiatus, la femme que tous adorent va peu à peu se défaire, de « zombifier » comme une momie dont on déferait les bandelettes, qui perdrait peu à peu sa substance. Déjà elle apparaît différente après avoir laissé son uniforme de motard, elle ne va cesser de changer d'apparence (les perruques), et de vêtement pour finir en corps d’adolescente qui a trop grandi, sans aucune once d’érotisme capable d’exciter les hommes qui tournent autour d’elles, chauve, comme si elle était malade, en phase terminale.
C’est la singularité de ce personnage que Mundruczó souligne dans sa mise en scène, qui oscille entre réalisme « bourgeois » et science-fiction, fumées, éclairages violents qui font rupture avec une trame où le livret joue ordinairement sur la normalité et le « léger » décalage qui crée le fantastique constitué par Emilia Marty.
La puissance de séduction de la femme qui était un des points forts du livret (et qui donnait au personnage une allure de star) est ici ailleurs : c’est la « singularité » de cette femme, son altérité, située entre vie, survie et mort, qui fait sa puissance.
Alors, autour de sa fin, une vision onirique de tous les meubles qui s’envolent, suspendus, pendant qu’Emilia va s’enfoncer dans le sol, non sans avoir vécu une sorte de transfiguration au moment où elle a énoncé la vérité sur sa (ses) vies.
Au réalisme apparent de la trame, Mundruczó souligne l’irrationnel grâce aux éclairages, très bien faits de Felice Ross, et à des artifices de théâtre : au total, un travail singulier qui s’appuie aussi sur la personnalité scénique de Rachel Harnisch, au format plus frêle que d’autres artistes ayant interprété le rôle car dans cette mise en scène, impossible d’imaginer une Mattila par exemple, ni même une Herlitzius.
Alors que les Emilia Marty habituelles « se posent là », même dans la mort, l’Emilia Marty de Mundruczó se désagrège peu à peu jusqu’au lambeau. C’est là l’originalité de ce travail qui marginalise d’entrée l’héroïne, en aveuglant les autres personnages, même les plus émouvants (Hauk-Šendorf voire Prus lorsqu'il apprend le suicide de son fils). En singularisant à ce point son héroïne, Mundruczó détruit aussi l’effet « thriller », rendant l’intrigue secondaire : l’enjeu est ailleurs.
La situation sanitaire a contraint le Grand Théâtre à éviter la présence en fosse de l’OSR, car l’orchestre de Janáček est plutôt fourni. En juillet dernier, Tomáš Netopil a enregistré la partie orchestrale et c’est cet enregistrement qui est utilisé. Ce n’est donc pas la solution zurichoise, où l’orchestre était en direct à distance. En revanche, le chef peut donner en dirigeant des indications à l’ingénieur du son pour moduler l’enregistrement selon les éléments qu’il veut valoriser et le volume par rapport aux voix : son rôle en fosse n’est donc pas seulement de diriger les chanteurs, mais aussi diriger le son.
Au départ, on est gêné parce que le son enregistré aplatit la rutilance si particulière de la partition de Janáček et l’enregistrement apparaît sans relief, sans profondeur, à deux dimensions. Il est clair que l’on ne peut prétendre à un rendu équivalent à la musique vivante (et heureusement…), mais dès que les chanteurs interviennent, on oublie cette gêne et le système subterfuge fonctionne. Et on peut dire que Netopil tient cet ensemble virtuel-présentiel (pour employer le détestable vocabulaire ambiant) avec l’attention voulue : on connaît depuis longtemps les qualités de ce chef notamment dans Janáček depuis les lointaines Katia Kabanova parisiennes de 2011. Il reste que voir ce chef diriger partiellement « à vide », même s’il a dirigé l’orchestre pour l’enregistrement fait une singulière impression, même s’il faut saluer la performance.
Du côté des chanteurs, la distribution pour les rôles principaux est semblable à celle de l’Opéra des Flandres, ce qui garantit une fidélité à la mise en scène et un esprit de plateau plus cohérent, mis c’est l’ensemble du plateau, y compris les nouveaux venus et notamment les membres du « Jeune Ensemble » qui est à la hauteur de l’enjeu. La difficulté de l’œuvre consiste à ce côté « conversation en musique » qui demande aux chanteurs à la fois la fluidité, l’expression, le naturel du théâtre, et néanmoins la voix chantée et colorée nécessaire. Aucun maillon faible dans une distribution remarquable.
Aleš Briscein est Albert Gregor, l’un des meilleurs ténors actuels de la république Tchèque (avec Pavel Černoch) qui chante évidemment très souvent Janáček, la voix est sonore et puissante, le timbre assez lumineux, il est toujours très expressif et bon acteur.
Excellent aussi, notamment par le phrasé et surtout très expressif le baryton-basse hongrois Karóly Szemerédy dans le rôle de l’avocat Kolenatý. Nous avions déjà remarqué Sam Furness à Zurich où il incarnait Albert Gregor. Il est ici Vitek, avec les mêmes qualités d’expression et de présence scénique, voilà un ténor à suivre assurément. Michael Kraus est impérial dans Jaroslav Prus ; le baryton viennois qui depuis septembre dirige l’Opéra-Studio du Wiener Staatsoper est ici non seulement prodigieusement expressif, mais montre aussi une belle présence qui fait donne à Prus du mordant et un véritable relief.
Il faut enfin saluer les trois membres du jeune ensemble, Julien Henric (Janek Prus) et surtout la Krista de Anna Schaumlöffel, vive, fraiche, avec une voix claire, acérée, vigoureuse, et Ludovit Ludha en Hauk-Šendorf, le seul personnage « de caractère », très juste dans cette figure à la fois bouffe, passionnée et dérisoire.
Mais tout ce petit monde est là pour tourner autour d’Emilia Marty, qui est Rachel Harnisch, une chanteuse qu’on connaît depuis longtemps, qui a souvent chanté avec Abbado, notamment Schubert et Mozart. Elle nous avait beaucoup plu dans La Juive à Lyon où nous avions loué son chant très habité. Elle est ici, comme à Gand, ce personnage engagé, incarné qui la rend à la fois impressionnante et bouleversante. Physiquement, elle ne cesse de se transformer, du motard initial, changeant de vêtements et peu à peu s’en débarrassant, effeuillée jusqu’à l’essentiel, comme si au fur et à mesure qu’on avançait dans l’œuvre elle ouvrait au monde sa vraie nature, son vrai corps si admiré et qui pourtant semble à la fin décharné et repoussant. Comme si cet « effeuillage » était effeuillage de l’âme jusqu’au noyau le plus profond et jusqu’au vrai. Une performance exceptionnelle, avec un sens du dire, une modulation des couleurs, de l’humour au sarcasme et à la déchirure, qui en fait une des très grandes Emilia Marty, à l’égal des plus grandes et sur un autre mode, à la fois plus humain et plus « ailleurs » : elle affiche son côté divers et polymorphe, dans l’aspect comme dans la voix au son très différencié selon les registres. Supérieur.
On comprend du même coup l’immense frustration que ce spectacle d’une grande solidité et magnifiquement distribué n’ait pu aller à Genève jusqu’à son terme. Dans un monde post-Covid, qui finira bien par arriver, il mérite une reprise, avec orchestre en fosse et les mêmes protagonistes, une salle pleine et évidemment un triomphe.
Une surprenante «Affaire» au Grand Théâtre de Genève
Sylvie Bonier - Le Temps - 28 octobre 2020
source: https://www.letemps.ch/culture/une-surprenante-affaire-grand-theatre-geneve
L’opéra de Leoš Janáček trouve une étonnante cohésion sur la scène de Neuve, malgré la bande-son préenregistrée de l’OSR. Défi relevé
Article réservé aux abonnés de cette publication
L'inquiétante étrangeté de L'Affaire Makropoulos
Stéphane Lelièvre - Bachtrack.com - 28 octobre 2020
source: https://bachtrack.com/fr_FR/critique-affaire-makropoulos-mundruczo-netopil-harn…
Une héroïne qui aura tenté les plus grandes, d’Elisabeth Söderström à Anja Silja, Hildegard Behrens, Catherine Malfitano ou Raina Kabaivanska (dans ce qui fut l’un de ses derniers rôles). Le choix de Rachel Harnisch (très justement acclamée au rideau final) pour incarner l’héroïne éponyme s’est avéré excellent, même s’il surprend dans un premier temps : dans ce rôle d’une cantatrice adulée dont un élixir de longue vie a prolongé l’existence durant plus de trois siècles, on attendrait a priori un soprano à la voix plus large (nombreuses sont les wagnériennes à s’être emparées du personnage) et peut-être plus âgé. C’est oublier cependant que les proches d’Emilia Marty (alias Elina Makropoulos) ne lui donnent pas plus de 30 ou 40 ans. Confier le rôle à une interprète dont la silhouette et la voix sont encore jeunes permet ainsi de créer l’étrangeté, le fantastique inhérents à l’œuvre : la voix saine de la chanteuse ne l’empêche nullement d’évoquer la lassitude, les fêlures, la fatigue dont est empreint le personnage.
L'Affaire Makropoulos à Genève : Janáček plus fort que le Covid
Didier Van Moere - Diapason - octobre 2020
source: https://www.diapasonmag.fr/critiques/l-affaire-makropoulos-a-geneve-jana-ek-plu…
Pas d'orchestre dans la fosse pour cette production venue de l'Opéra des Flandres, mais une bande préenregistrée, affûtée par la direction incisive de Tomáš Netopil.
Jauge limitée à mille personnes. Pas d'orchestre dans la fosse, pour les raisons que l'on sait. Tout a été préenregistré et des enceintes ont pris la place des différents pupitres. Seul Tomáš Netopil est là et dirige les chanteurs. A dire vrai, cela fonctionne bien... et, surtout, la production est sauvée.
Le cinéaste ne se renie pas : dans un décor très inspiré de Marcel Breuer, on se situe entre Bergman et Pasolini, entre la crudité du réalisme et l'étrangeté du fantastique. Le vieux Hauk-Sendrof, par exemple, semble venir de l'au-delà, les objets de l'appartement, à la fin, s'élèvent du sol tandis qu'Elina disparaît sous le plancher. Malgré une direction d'acteurs fouillée et pleine de rythme, l'histoire perd seulement un peu de son mystère - et on nous a déjà plusieurs fois fait le coup de la perfusion...
Les chanteurs adaptent parfaitement leurs mots et leurs notes à la situation, relevant le défi. A commencer par Rachel Harnisch, déjà Elina dans les Flandres. La voix est limitée à ses extrêmes, l'homogénéité de la tessiture laisse à désirer, le timbre est sans attrait ? Autant de défauts qu'elle transcende par l'intensité de son chant et de son jeu, formidablement identifiée au personnage tel que le veut la production. Autour d'elle gravitent des personnages bien campés, vocalement très solides : Albert éperdu d'Aleš Briscein, malgré un aigu à la peine, Vitek aviné de Sam Furness, Prus racé de Michael Kraus, impeccable Kolenatý de la basse mordante de Karoly Szemeredy... tous sont excellents. Mais la palme revient à Tomáš Netopil, pour sa direction rythmiquement incisive, aux couleurs crues, très narrative, jamais décousue surtout, qui rend donc l'œuvre à sa fascinante modernité.
Une femme fatale
David Verdier - Altamusica.com - 28 octobre 2020
source: http://www.altamusica.com/concerts/document.php?action=MoreDocument&DocRef=6753…
Pour sa première apparition sur la scène du Grand Théâtre de Genève, l'Affaire Makropoulos de Janáček bénéficie d'une scénographie façon film noir signée Kornél Mundruczó, avec un plateau dominé par la performance de Rachel Harnisch et la direction de Tomáš Netopil à la tête d’un Orchestre de la Suisse Romande placé à distance sanitaire.